Le Grec, 25 000 pitons après
Montagnes Magazine N° 62 mai 1984 - Propos recueillis par
Bernard Amy et Pascal Sombardier
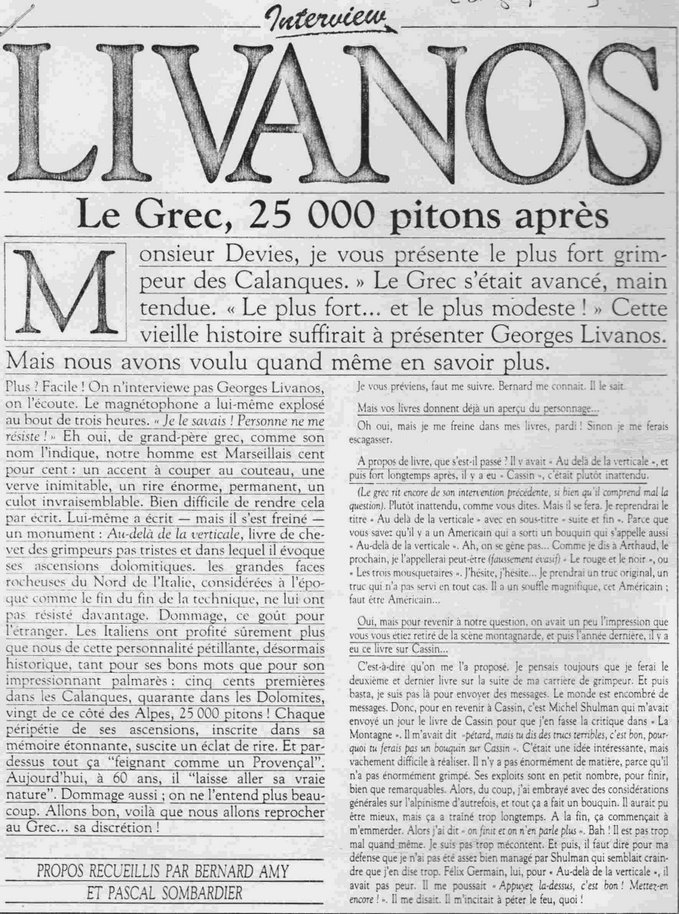




LE GREC, 25 000 PITONS APRÈS
Propos recueillis par Bernard Amy et Pascal Sombardier (Montagnes Magazine N° 62 mai 1964).
« Monsieur Devies, je vous présente le plus fort grimpeur des Calanques. » Le Grec s’était avancé, main tendue. « Le plus fort… et le plus modeste ! » Cette vieille histoire suffirait à présenter Georges Livanos. Mais nous avons voulu en savoir plus.
Plus ? Facile ! On n’interviewe pas Georges Livanos, on l’écoute. Le magnétophone a lui-même explosé au bout de trois heures. « Je le savais ! Personne ne me résiste ! » Eh oui, de grand-père grec, comme son l’indique, notre homme est Marseillais cent pour cent : un accent à couper au couteau, une verve inimitable, un rire énorme permanent, un culot invraisemblable. Bien difficile de rendre cela par écrit. Lui-même a écrit – mais il s’est freiné – un monument : Au-delà de la verticale, livre de chevet des grimpeurs pas tristes et dans lequel il évoque ses ascensions dolomitiques, les grandes faces rocheuses du Nord de l’Italie, considérées à l’époque comme le fin du fin de la technique, ne lui ont pas résisté davantage. Dommage, ce gout pour l’étranger. Les Italiens ont profité sûrement plus que nous de cette personnalité pétillante, désormais historique, tant pour ses bons mots que pour son impressionnant palmarès : cinq cent premières dans les Calanques, quarante dans les Dolomites, vingt de ce côté des Alpes, 25 000 pitons ! Chaque péripétie de ses ascensions, inscrire dans sa mémoire étonnante, suscite un éclat de rire. Et par-dessus tout ça « feignant comme un Provençal ! ». Aujourd’hui, à 60 ans, il « laisse aller sa vraie nature ». Dommage aussi ; on ne l’entend plus beaucoup. Allons bon, voilà que nous allons reprocher au Grec… sa discrétion !
- "Je vous préviens, faut me suivre. Bernard me connait. Il le sait."
- Mais vos livres donnent déjà un aperçu du personnage…
- Oh oui, mais je me freine dans mes livres, pardi ! Sinon je me ferais escagasser.
- À propos de livre, que s’est-il passé ? Il y avait « Au-delà de la verticale », et puis fort longtemps après, il y a eu « Cassin », c’était plutôt inattendu. Le Grec rit encore de son intervention précédente, si bien qu’il comprend mal la question.
- Plutôt inattendu, comme vous dites. Mais il se fera. Je reprendrai le titre « Au-delà de la verticale ». Ah, on ne se gêne pas… Comme je dis à Arthaud, le prochain, je l’appellerai peut-être (faussement évasif) « Le rouge et le noir », ou « Les trois mousquetaires ». J’hésite, j’hésite… Je prendrais un truc original, un truc qui n’a pas servi en tout cas. Il a un souffle magnifique cet Américain ; faut être Américain…
- Oui, mais pour revenir à notre question, on avait un peu l’impression que vous vous étiez retiré de la scène montagnarde, et puis l’année dernière, il y a eu ce livre sur Cassin…
- C’est à dire qu’on me l’a proposé. Je pensais toujours que je ferai le deuxième et dernier livre sur la suite de ma carrière de grimpeur. Et puis basta, je suis pas là pour envoyer des messages. Le monde est encombré de messages. Donc, pour en revenir à Cassin, c’est Michel Shulman qui m’avait envoyé un jour le livre de Cassin pour que j’en fasse la critique dans « La montagne ». Il m’avait dit « pétard, mais tu dis des trucs terribles, c’est bon, pourquoi tu ferais pas un bouquin sur Cassin. » C’était une idée intéressante, mais vachement difficile à réaliser. Il n’y a pas énormément de matière, parce qu’il n’a pas énormément grimpé. Ses exploits sont en petit nombre, pour finir, bien que remarquables. Alors du coup, j’ai embrayé avec des considérations générales sur l’alpinisme d’autrefois, et tout ça a fait un bouquin. Il aurait pu être mieux, mais ça a trainé trop longtemps. À la fin, ça commençait à m’emmerder. Alors j’ai dit « on finit et on n’en parle plus ». Bah ! Il n’est pas trop mal quand même. Je suis pas trop mécontent. Et puis, il faut dire pour ma défense que je n’étais pas assez bien managé par Shulman qui semblait craindre que j’en dise trop. Félix Germain, lui, pour « Au-delà de la verticale », il avait pas peur. Il me poussait « Appuyez là-dessus, c’est bon ! Mettez-en encore ! » il me disait. Il m’incitait à péter le feu, quoi !
- Alors ce livre, c’était pour vous l’occasion de lancer quelques piques par ci, par là ?
- Contre certains grimpeurs « modernes », oui ! Moi aussi, j’ai été moderne. Cassin aussi ! Tout le monde est toujours moderne.
- Vous pensez donc du mal des grimpeurs « modernes » ?
- Non, les grimpeurs ont toujours été des gens valables, habiles, mais ce n’est pas suffisant à mon avis, pour être un vrai grimpeur. Il faut être un homme courageux et affronter vraiment des choses qui engagent, beaucoup plus que simplement faire quatre gestes plus ou moins audacieux dans un surplomb. Et puis, il y a une proportion de snobs, de cabotins… Mais il ne faut pas leur jeter la pierre, finalement. Ça les amuse de se comporter comme ça. À la fin, de toute façon, on voit les résultats, les niveaux. Ce qu’il y a, c’est que même les grands maintenant, ils sont obligés de « snober » pour se faire remarquer. Ils ont des attitudes qui, au fond, ne sont pas indispensables. Moi, je vois des photos de Messner avec des chapeaux extrêmement curieux, des vestes farfelues, des barbes qui varient d’un jour à l’autre. C’est Gainsbourg, quoi ! Ça n’empêche pas que je respecte Messner, même s’il se croit obligé de se créer une silhouette de dur, de casseur, de western, de Zorro, et tout ce qu’on voudra.
- Vous pensez qu’il a vraiment besoin de ça ?
- Il n’en a pas besoin à mes yeux. Moi, je pourrais le voir habillé en notaire, ce serait toujours « Monsieur » Messner. Il ne suffit pas d’avoir la barbe et le chapeau pour être Messner. Parce qu’à l’inverse, il y a ceux qui n’ont que l’image de marque…
- Mais vous-même, vous vous entourez bien d’un certain folklore !
- Oui, j’avais mon pull-over rouge avec la Grecque noire sur la manche, et j’affectais toujours d’allumer une cigarette quand j’arrivais au refuge. Des fois, il ne m’en restait qu’une ; je mourrais d’envie de la fumer depuis deux heures, mais je ne fumais pas. Seulement quand j’arrivais, la corde en travers, « le grec arrive ». Alors je ne peux pas jeter la pierre aux jeunes. J’ai été aussi cabotin qu’eux… Mais même là, donc, ils n’ont rien inventé (il rit).
- Mais Messner, lui, est obligé de cultiver son image auprès du grand public, plus qu’auprès du « milieu ».
- C’est vrai, il est obligé de créer son personnage de vedette. Mais remarquez que moi, je le créais encore plus bêtement, puisqu’il ne me rapportait rien. Je n’ai jamais été professionnel de quoi que ce soit. On ne me reprochera pas quand même deux livres en vingt-cinq ans pour me traiter de « sordide professionnel de l’Alpe ». Je n’ai jamais touché un radiguoin de la montagne.
- Vous viviez de quoi alors ?
- Ben, je travaillais, eh ! Pas énormément, parce que je ne suis pas du genre acharné. J’ai été dessinateur chez un architecte, puis représentant, puis fonctionnaire à la sécu. Je ne grimpais que le dimanche. Comme Cassin.
- Comme Ugo Manera aussi, qui est ouvrier chez Fiat et pour qui les jeunes grimpeurs sont des parasites sociaux.
- Oh ça alors, si on commençait à faire la liste des parasites sociaux sur la planète, y aurait pas que les jeunes grimpeurs, hein ! Y a pas mal de types dont on pourrait aisément se passer, ou envoyer au charbon… Et des gens très bien… Ceux qui vivent de belles paroles. Les jeunes grimpeurs qui ne travaillent pas, ils n’emmerdent personne ; alors ? De toute façon, ils font tous des petits boulots de temps en temps, et quand ils ont quatre sous, ils partent en montagne. Il y a trente ans, ça existait déjà. Poincenot, par exemple, qui s’est tué en allant au Fitz Roy avec Terray. Il demandait sans arrêt trois mois de congés. Il revenait, il disait « je suis de retour, vous me voulez pas ? » Alors les autres grommelaient « Ah, mais vous allez encore nous faire le coup l’été prochain ». Poincenot répondait « Ah ça… bien sûr ! » (il se tord de rire).
- Vous aviez beaucoup de contacts avec ce milieu parisien de grimpeurs ?
- Oh oui, parce qu’à l’époque, ils venaient beaucoup par ici. Et puis, à Marseille, il n’y avait que quinze à vingt grimpeurs. On était donc devenus assez copains avec Pierre Allain, Ferlet, Poulet, Bérardini, Paragot etc.
- N’y avait-il pas quelques rivalités ?
- Oh, certains avaient bien essayés de jouer les pions, comme Maurice Martin, mais pas les très forts (sourire). Faut dire qu’on était vachement jeunes, et donc on était vachement cons ! On faisait les pires des imbécilités. Mais je ne regrette pas de les avoir faites, parce que ceux qui ne les ont pas faites, c’est qu’ils n’ont jamais été jeunes. Et tant pis pour eux. Et puis, ceux qui étaient trop sérieux, ils ont souffert. Une fois au Saussois, on a vu la tente de Maurice Martin qui volait… très haut dans le ciel… « on » lui avait coupé les amarres ! C’était le jour de l’inauguration d’un refuge au sommet. Il y avait Devies et toute la bande… On a tous cru que c’était un satellite… et le père Devies, il se marrait parce qu’il savait qui avait fait le coup ! C’est surement Paragot et Bérardini, mais faut pas le dire. C’étaient des méchants ceux-là… mais très gentils quand même…
- Vous n’avez jamais tellement eu le gout pour la haute montagne !
- D’abord on ne se déplaçait pas comme aujourd’hui. On ne changeait pas de programme facilement. Mes « grandes années » se situent il y a trente ans. C’est déjà loin. Une tranche de trente années, c’est lourd dans l’histoire alpine. Mais c’est par Chamonix que j’ai commencé. J’ai fait l’aiguille du Tour à treize ans. J’ai appris à grimper aux Gaillands, avec les guides. J’y allais en vacances avec mes parents. Je ne suis allé dans les Calanques que trois ans plus tard. J’ai fait la deuxième de la Saphir à seize ans. Bon, maintenant, les Dolomites ça vient du fait qu’à Chamonix, on visait toujours de faire « cette » Walker, et il y avait toujours quelque chose qui allait pas, parce qu’on avait qu’un mois, il faut le temps de se réadapter au granite, de s’entrainer, et puis quand on est bien prêt, il arrive le bel orage, et on repart sans avoir rien fait de marquant. Alors, un jour, on est allé dans les Dolomites. On s’est aperçu qu’on avait davantage exploité notre mois. C’était en plus un terrain qui nous convenait mieux. Grimpant toute l’année sur du calcaire, nos chances de succès – Eh oui ! L’esprit de compétition – étaient plus élevées… sur du calcaire. Imaginons que lors du concours du meilleur ouvrier de France, un ébéniste se lance dans la ferronnerie, ce serait un jobard complet. Je ne dis pas que j’ai été en perdition sur le granite. D’ailleurs je n’ai jamais été en perdition nulle part, quitte à mettre un clou de plus… Mieux vaut un clou de plus, comme je l’ai toujours dit, qu’un homme de moins. Surtout quand cet homme-là, c’est moi (faussement dédaigneux). Les autres, ça, ils peuvent descendre en grappes, leur sort ne m’intéresse qu’assez peu. Bon, alors on est retourné dans les Dolomites. Surtout qu’entre temps, j’avais entendu parler de la Su Alto. Ah, mais je me dis, « Oh, faut que j’aille faire ce truc-là ! Tous les grands l’ont pas faite ! » Je fais péter les bretelles. Et on l’a fait ! Alors, cela a été la gloire dans le coin. Et dès qu’on a la gloire, on a beaucoup d’amis. Les Italiens sont capables d’être très amicaux, avec moins de superficialité que ce qu’on pourrait croire. J’ai rencontré des gens simples, sympathiques, de vrais montagnards, bien au-delà du « réta bleausard » et des petits snobismes citadins. Pour eux, je n’étais pas un visiteur, un « touriste », j’étais comme eux, et c’est ce qui m’a lié à ces montagnes, à ces hommes : Gino Solda, Cassin, Bruno et Catullo Detassis, Vinatzer, etc. On était invité de ci, de là. Et en plus, en 50, les renseignements sur les Dolomites étaient rares, pas du tout standardisés comme aujourd’hui. C’était déjà une aventure… Je n’ai donc fait que de rares réapparitions sur le granite ; à Sialouze, par exemple, en Oisans… a face sud-ouest qui est devenue classique.
- Vous grimpiez en Vibram ?
- Sialouze ! Oui. Depuis 50, on a toujours grimpé en Vibram. En 50, j’avais encore fait la Cima Ovest en baskets, des baskets en caoutchouc. Ça ressemblait aux P.A. On les prenait avec des pointures très inférieures, et c’était serré ! On les enlevait avec plaisir. Après, on a découvert de faire armer les Vibram, et c’était bien pratique pour rester immobile quand on pitonnait. Les jeunes de la nouvelle vague, là, avé leurs chaussures de gymnastes, ils ne peuvent faire que des voies déjà pitonnées ! Mais… ils savent se bloquer sur une main, trouver des positions qui ne fatiguent pas, avec leur entrainement de fer.
- Vous ne vous entrainiez pas du tout ?
- On travaillait jusqu’au samedi matin ! Je regrette de ne pas m’être entrainé comme eux, parce que peut-être que ça les aurait emmerdés (il rit pendant plusieurs secondes). Ils se seraient trouvés moins bons.
- On vous imagine mal sur une barre fixe.
- Oui, je n’ai pas l’esprit. Je ne suis pas comme Edlinger qui me dit « Moi je fais quarante trucs de ceci ou soixante-dix de cela ». Aujourd’hui, les grimpeurs sont devenus de véritables sportifs. Nous, nous n’étions pas encore des sportifs. Nous étions simplement des grimpeurs. On faisait bien des marathons, comme celui de la Candelle ; on grimpait le socle, la face, on redescendait l’arête de Cassis, et puis une ou deux autres voies. Mais ça se passait dans une ambiance simplement… d’escalade. Pas de développent des muscles, de la souplesse…
- Que pensez-vous de la dépréciation de l’escalade artificielle ?
- Elle est logique, du moment que l’escalade progresse. Ou alors, elle ne progresserait pas. Il reste des cas où l’escalade artificielle est obligatoire. Nous, nous n’avons peut-être pas grimpé en libre partout où cela était possible, mais c’est aussi une question d’état d’esprit. Autrefois, le Mont Blanc était une expédition. Aujourd’hui, de simples marcheurs peuvent le faire dans la journée.
- Mais l’artificielle a bien été considérée comme le « nec plus ultra » à une certaine époque. Un certain Livanos a même dit « j’ai planté 25 000 pitons dans ma vie ». C’est donc bien que cela représentait une valeur…
- Oui, ça représentait un effort, mais je n’ai jamais estimé que l’artificielle était supérieure à l’escalade libre. C’était un moyen de progresser et il n’y en avait pas d’autres. Encore que des gens comme Vinatzer et Comici, on n’avait rien à leur apprendre. Il y a des pas qui sont encore côté VII inf, ouverts en 1933, par papa Vinatzer. Et il faut voir ce qu’il avait aux pieds (il s’étouffe de rire)… C’est comme s’il avait des gants de toilette… sur les pieds. Disons qu’aujourd’hui, les Alpes, c’est l’école d’escalade pour l’Himalaya. Il n’y a plus d’alpinisme. Quand on voit Profit qui fait les Drus en 3h10… (changement de ton), Pfff !!... Y perd son temps ce mec, alors… pas possible… y fout rien… le fainéant… Un véritable provençal ! Y doit se dorer au soleil sur toutes les plates-formes (il rit). Enfin, comme je lui disais « finalement, tu marches à la vitesse de 400 mètres à l’heure, c’est l’horaire normal pour un marcheur qui monte un sentier au refuge. Alors au fond, pour toi l’alpinisme, ça doit être d’une monotonie infernale… C’est toujours 400 mètres à l’heure ! Le refuge, les Drus, la Nord des Droites… t’en as pas marre ?... » Ah, il rigolait quand même, parce qu’il sait qu’au fond, je ne suis pas méchant. Je me fous de tout le monde, même de moi… Il faut savoir rigoler dans la vie. Enfin, tout ça pour dire que les vrais exploits, ça se fait dans l’Himalaya maintenant, pas dans les Alpes.
- Ça ne vous est jamais arrivé d’aller là-bas ?
- À mon époque, ce n’était pas facile d’y aller. Il aurait fallu que j’aie des connaissances plus étendues sur l’escalade glaciaire. J’ai été sollicité pour le Cerro Torre. J’ai refusé. Je ne veux pas commander, ni obéir. Cela aussi c’est l’escalade libre. Ce n’était pas ma place. D’ailleurs, si on avait mis Herzog dans les grandes faces dolomitiques, ce n’aurait pas été sa place non plus, hein ! Lui et Terray, par exemple, ne touchaient pas une bille dans les Dolomites. Je ne dis pas ça pour les dévaluer, mais c’est vrai.
- Et Rébuffat, Marseillais lui aussi ?
- Ah, lui s’est relativement bien comporté. Il n’a jamais fait de trucs transcendants, mais c’est un type très complet ; un grimpeur pas brillant, mais sûr. J’aimais grimper avec lui pour ça. Avec lui, on avait presque cent pour cent de chances d’arriver en haut. Comme les gens qui grimpaient avec moi, c’était pareil… Enfin, disons 98% de chances… Il y en avait d’autres, plus brillants, mais avec qui je ne serai pas parti.
- Vous avez ouvert combien de voies ?
- Oh, une quarantaine dans les Dolomites et une vingtaine dans le reste des Alpes.
- Sans compter les Calanques ?
- Ah non, les Calanques, je ne suis pas loin de 500, là. Enfin je ne sais pas le compte exact, mais c’est Rébuffat qui me l’a dit. Il doit faire comme les grimpeurs modernes, il compte les variantes. Maintenant, on fait 40 mètres, on tombe dans une autre, et on dit que c’est une voie !
- Évidemment, vous ne nous avez pas laissé de place, alors…
- Oui, je reconnais que j’ai été très méchant.
- Il y a combien de voies dans les Calanques ?
- Oh, maintenant deux ou trois mille. Mais, enfin quand j’ai eu fini mes 500, il n’y en avait qu’un millier en tout. C’est-à-dire que la moitié des Calanques était à moi (il s’esclaffe). J’aurais dû mettre des troncs, comme dans les églises !
- Et Sonia ? Parlons d’elle.
- Sonia, elle a beaucoup grimpé avec moi. Den fait, elle ne s’appelle pas Sonia, mais Geneviève. Ça vient de Tartarin. Dans « Tartarin dans les Alpes », Tartarin avait rencontré une Russe qui s’appelait Sonia, à qui il disait toujours d’un ton très affectueux (théâtral) « Vous me connaissez, Sonia ! » Alors, après, c’était devenu un gag dans les Calanques avec les copains, les premiers temps que je la connaissais. Quand c’était difficile, ils disaient tous « Vous me connaissez, Sonia ! » Et voilà pourquoi toutes les grimpeuses de Marseille s’appellent Sonia. Oh la mienne a fait l’usage. Elle grimpait bien. Elle cherche pas s’il y a de prises à gauche, à droite. Ah, c’est pas Edlinger, hein ! Elle grimpe toujours comme sur une échelle. Elle est pas souple. Je ne sais pas comment elle se démerde. Nous on a fait des pétards d’enjambées effroyables ; elle, elle monte… droit.
- C’était quoi, votre expression à son sujet, dans « Au-delà de la verticale » ?
- Ah oui… (il cherche). Ah, je ne m’en rappelle plus. Ah, ah, j’ai dit tellement de conneries !
- Est-ce que vous avez grimpé en…
- (À Bernard Amy). Mais tu veux que j’ai grimpé sur la planète entière ! Pourquoi pas en Australie ? On ne se déplaçait pas comme maintenant ; les jeunes… enfin, jeunes… t’es plus tellement jeune, toi maintenant, alors ramène pas ta gueule (rire sardonique). Joue pas les gamins ! Moi j’avais mes habitudes. Dans les refuges, j’avais « ma » chambre, voilà. Une fois je suis arrivé, elle était occupée. Et bien la gardienne, elle est allée voir le type ; elle lui a dit : « Vous avez la chambre 10, c’est celle de Livanos. Il vient d’arriver : alors vous videz ! » Le type, il a dit « Parfait ! » Il a replié toute sa baraque, il a disparu.
- Sans poser de question ?
- Non, non. Y’avait pas de question à poser « il est là ». C’est terminé ! Tu la veux comment, la clé de la chambre 10 ? Aux herbes de Provence ou en mayonnaise ? (il s’esclaffe). Ça c’était génial… le type après… Tout ravi d’avoir couché dans ma chambre.
- Vous aimiez les Dolomites pour ça aussi, non ?
- Ah, c’est pas désagréable… Parce qu’en France, pour être envoyé coucher comme un chien à coups de pied dans le cul… ! Une fois, aux Bans, j’ai été parqué dans un angle du refuge… Il fera chaud le jour où tu me reverras, pauvre con !... Tu rigoles dis ! T’irais dans les Dolomites, on te laverait la tronche au charbon !
- Vous avez été l’âme d’un club qui s’appelait le GGM, le groupe de grimpeurs marseillais ?
- Oui, comme toujours, ça s’est resserré autour d’un gars, parce que c’est lui qui grimpe le mieux, qui parle le plus (sourire). Ah, c’était comme le GHM, il fallait être parrainé pour y rentrer… des références quoi. Parce que si c’était pour y faire entrer des rigolos… Enfin, on demandait de passer du IV en tête. C’est comme si aujourd’hui on demandait du V en tête.
- Ce club était né de rivalités avec le CAF ?
- Oh, ben, il y en a toujours eu. D’ailleurs le superbe GHM, il est né de quoi ? De la même chose. C’était des éléments vraiment alpins de Paris, les Lagarde and Co, qui l’avaient fondé parce qu’ils étaient « en bisbille » avec le CAF.
- Le GHM, ça vous parait avoir encore un sens aujourd’hui ?
- L’autre jour, j’ai reçu un questionnaire. J’ai dit que ce n’était plus la peine, que c’était dépassé. Il faudrait faire un « Super GHM », avec ceux qui ont fait vraiment des courses extrêmes et en Himalaya. Parce que les critères actuels du GHM conduisent à mettre Messner et un fort grimpeur de Fontainebleau dans le même panier. Ce que fait Messner, c’est plus noble que le bloc. Le GHM ne doit pas consacrer que des virtuoses physiques. Mais peut-être que les médailles ne sont plus de mises. Il y a eu un tas de choses qui ont disparu ; les duels ou les tournois, par exemple. Maintenant, vous verriez un tournoi, vous diriez ; « Mais qu’est-ce qu’il fait sur son bourrin, ce con ! »
- Pourquoi avez-vous arrêté de grimper il y a cinq ans ?
- Je sentais que ça me fatiguait davantage. Alors, je préférais m’arrêter sur de bons souvenirs, plutôt que des souvenirs de IV, puis de III, où je me serais arraché les tripes pour faire de petites courses. Il aurait fallu que je m’entraine toujours plus pour devenir plus mauvais. Ce n’est pas une bonne formule. Organiser une ascension, c’est bien. Freiner une descente, c’est moins élégant. Quand on grimpe, il faut grimper bien, ou ne pas grimper. J’étais à En Vau, il y a quelques temps, et j’ai vu un mec qui descendait un éboulis à toute allure, sans doute pour montrer ses restes de jeunesse. Et ils étaient réels : cheveux blancs, buriné, en petit short et tee-shirt, cliquetant de coinceurs et descendeurs. Mais son regard était fixe et son sourire n’était qu’un rictus. Il m’a fait de la peine. Pour moi, malgré tous ses efforts, il n’était qu’un sinistre gâteux. Brasillach a dit : « La jeunesse pare de grâce tout ce dont elle s’occupe. À vouloir la prolonger, on risque de n’aboutir qu’à une caricature… » J’ai toujours grimpé très en-dessous de mes possibilités – Le manque d’audace est à la base – Sinon, il est probable que mes successeurs auraient, parfois des ennuis. Ainsi, au sommet de la Su Alto, en 1951, avec Robert Gabriel, regrettions-nous de ne pas avoir rencontré de passages plus difficiles. Gabriel n’était pas un grimpeur brillant, mais il a toujours été pour moi un merveilleux compagnon. Je n’ai qu’un regret : qu’il se soit arrêté en 1955, ce qui m’a sans doute privé de quelques belles réalisations, car je n’ai plus rencontré, sinon occasionnellement un autre Robert Gabriel. Sur le plan moral, énergie, imperméabilité à l’adversité, Gabriel, c’était un mec !
- Vous avez toujours été en retrait des institutions. Actuellement, bien que vous représentiez quelque chose, on n’entend guère parler de vous.
- Ce n’est pas de la modestie… (sourire) C’est… C’est au fond un sommet de l’orgueil… Le cul sur l’Olympe… On n’aborde pas les Dieux. Vous avez de la chance, entre parenthèses… Faudra le mettre sur votre carte de visite, « Je lui ai parlé ! » (il s’esclaffe). En ce qui concerne ces machins officiels, où tout le monde fait son numéro de cirque, d’abord ça ne sert à rien, sauf pour certaines personnes, à se montrer ; et en général, se montrent davantage ceux qui ne se montrent plus sur le terrain. Dans ces réunions, il ne sort rien de constructif. C’est Bruxelles, quoi ! Et puis, je suis peut-être passé de mode.
- Peut-être, mais dans les institutions, il y a des gens qui veulent et peuvent faire un peu de boulot.
- Ah, ah, ah ! Mais alors là, comme dit Coluche : « Le dernier qui m’a vu travailler, il est vieux ! » (il s’étrangle de rire). Travailler pour moi, ça m’a toujours emmerdé. Tu m’as vu travailler pour les autres ! Feignant comme je suis (À Bernard Amy) tu te rends pas compte, tu es un pousse-au-crime ! Tu veux ma mort !
- Sans parler d’institutions, pourquoi ne vous êtes-vous pas mis davantage sur le devant de la scène ? N’est-il pas dommage que vous n’ayez davantage valorisé vos livres, par exemple, lesquels sortent un peu des sentiers battus et ennuyeux de la littérature alpine ?
- Ah, je reconnais que, côté monuments, les pyramides à côté, ça fait léger !… Ceci dit, les gens lisent de moins en moins. C’est pour ça qu’il y a tous ces livres illustrés, que je ne lis jamais, puisqu’il n’y a rien à lire. Je ne parle pas des « cent plus belles courses », qui ont au moins un côté utile. Mais enfin, il n’y a presque plus de récits intéressants. C’est pas pour me vanter, mais… moi, j’aime surtout lire les miens. Les trois quart des livres se sont enfermés dans une espèce de « classicisme ». Quant à moi, si j’écrivais un autre livre, je ne pourrais pas me renouveler. On est prisonnier de sa manière d’écrire. Pour terminer, je vais vous faire une confession : mes 25 000 pitons, c’était de la pub. J’ai grimpé pendant 40 ans ; alors, 52 dimanches par an, 52 x 40 = 2080. À 10 clous par dimanche, je ne suis pas loin des 20 000. Ajoutez les week-ends prolongés, les fêtes et les vacances et vous verrez que le Grec n’a pas passé sa vie sur des étriers !